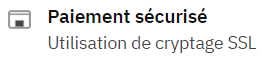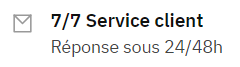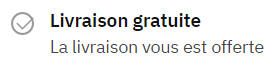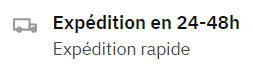Dans les arts de scène japonais, kyūtei-fuku ne désigne pas un seul vêtement mais un système de signes : l’ensemble des tenues issues de la culture de cour (Heian → Edo) et leur traduction scénique. Leur fonction n’est pas seulement décorative ; elles codent le rang, l’âge, le genre performé, l’étiquette et, très souvent, la temporalité (mythisée) du récit. Cet article propose une lecture comparée (bugaku/gagaku → Nō → kabuki/nihon-buyō) avec un accent sur la morphologie, les tissus, la polychromie yūsoku et les techniques de jeu que ces costumes exigent.

1) Généalogie : de la cour de Heian à la scène
- Bugaku (舞楽) : danse de cour liée au gagaku. Les costumes pour les danses de gauche (saho) héritées des Tang se construisent sur des rouges/or ; ceux des danses de droite (uho), associés à l’aire coréenne/indienne, privilégient verts/bleus. Silhouette emblématique : sashinuki (pantalon « ballon » à ourlet froncé), tuniques superposées (hō), armatures d’épaules, et parfois masque (p. ex. Ranryō-ō).
- Tenues de cour civiles :
- Sokutai (束帯), tenue cérémonielle masculine : grande robe, longue traîne (mo), coiffure kanmuri laquée et bâton shaku.
- Ikan (衣冠), version moins solennelle.
- Kariginu (狩衣) et noshi/suō (直衣/素襖), port d’aisance aristocratique.
- Jūnihitoe (十二単), système féminin de strates colorées (kasane no irome), court manteau karaginu + train mo, éventail hiōgi.
Ces matrices formelles irriguent ensuite Nō et kabuki, souvent allégées, hybridées et dramaturgisées.
2) Nō : yūsoku-mon’yō et dramaturgie de la lenteur
Dans le Nō, la cour n’est pas reconstituée : elle est évoquée. Le costume participe à une poétique de l’allusif (yūgen).
- TYPES DE TISSUS / TISSAGES
- Karaori (唐織) : satin broché pour rôles féminins nobles ; densité de trame élevée, reflets mats → gravité et retenue.
- Atsuita (厚板) / noshime : robes masculines à motifs géométriques/de cour (yūsoku-mon’yō : paulownia kiri, nuages kasumi, vagues seigaiha…).
- Nuihaku / surihaku / kirihaku : application de feuilles d’or/argent et broderies qui « éclairent » le plateau sans heurter la pénombre.
- FORMES SIGNIFIANTES
- Karaginu-mo scénique (version condensée) + masque ko-ōmote = jeune dame de la cour ; fukai = matrone ; shakumi = mélancolie.
- Suikan/kariginu + eboshi (coiffe souple) = aristocrate juvénile ou messager de cour.
- Kanmuri et shaku raréfiés mais hautement indexicaux : dès qu’ils apparaissent, ils « scellent » le rang.
- EFFETS SUR LE JEU
- Poids (6–10 kg pour certains karaori) → centre de gravité bas, micro-pas glissés (hakobi), gestion de la traîne (shizuri) au son de la flûte nōkan.
- La couleur n’est jamais naturaliste : elle instaure une valeur rituelle (p. ex. cramoisi = intensité/affect, vert/bleu = liminalité).
3) Kabuki / Nihon-buyō : spectacularisation et « technologies » du costume
Le kabuki hérite et spectacularise les codes de cour.
- Hikinuki (引抜) et bukkaeri (振り返り)
Techniques de dérobade qui permettent la métamorphose : un ikan noir peut « s’ouvrir » en jūnihitoe éclatant, révélant la nature véritable (princesse, esprit de fleur). - Samouraïs et cour
Les nobles de cour alternent ikan/kariginu ; les kamishimo (kataginu + hakama) restent marqueurs de bushi, non de courtisans, et sont délibérément juxtaposés pour des dramaturgies de rang en conflit. - Femmes de Heian
Le karaginu-mo devient modulable : allègement des couches, manches élargies pour la danse (buyō), perruques (katsura) très longues pour l’effet « Genji ». - Palette yūsoku et lisibilité
Les combinaisons kasane saisonnières (p. ex. uguisu no kasane, asagi no kasane) sont recomposées pour la visibilité sous projecteurs modernes ; l’or appliqué remplace parfois des armures textiles lourdes.
4) Ce que dit la silhouette : sémiotique rapide
| Élément | Indice scénique | Effet de jeu |
|---|---|---|
| Kanmuri + shaku | Haute fonction de cour, proximité rituelle | Dignité, axe vertical, démarches mesurées |
| Sashinuki (pantalon ballon) | Élégance Heian, jeunesse aristocratique | Pas amples, traction au sol contrôlée |
| Mo (traîne/apron) | Cérémonial (H/F) | Gestion de la traîne, virages lents |
| Karaginu-mo (F) | Dame de la cour | Mouvements bras/poignets codifiés, hiōgi |
| Kariginu / Suō | Détente de noblesse | Mobilité accrue, transitions rapides |
| Nuihaku / haku-mono | Aura surnaturelle / noblesse | Scintillement rythmique, pauses tenues |
5) Tissus, armures textiles et maintenance (atelier)
- Armure textile : kinran, donsu, rinzu (satin façonné) ; les ateliers contemporains remplacent parfois par polyester haute densité pour maîtriser le poids et la sueur sans perdre la lecture des motifs.
- Renforts : doublures en asa (chanvre/ramie) pour respirabilité ; entoilages amovibles au niveau des empiècements d’épaule (kabuki).
- Vie de plateau :
- Aération après chaque représentation (éviter l’oxydation de la feuille or/argent).
- Sac de sommeil en washi non acide pour les pièces anciennes ; bannir cintres métalliques.
- Petit outillage en coulisse : pince plate pour kanmuri, lingettes alcool isopropylique pour shaku, ruban de soie pour ligatures « invisibles » avant hikinuki.
6) Direction d’acteur : étiquette et cinétique
- Assise et salutations (rei) : en kyūtei-fuku, les angles (coude/poignet) sont d’amplitude réduite ; la pointe du hiōgi descend en diagonale, jamais en trajectoire frontale.
- Marche : l’enchaînement suri-ashi → hakobi doit intégrer la résistance de la traîne ; prévoir un compas plus large en sashinuki pour éviter le gonflement parasite.
- Main gauche / shaku : maintenir une ligne médiane stable ; la main droite « parle » minimalement (Nō) ou déploie une frise gestuelle (buyō).
- Respiration : travailler sur ma (間) — dilatation/condensation temporelle — car la densité textile ralentit la cinétique naturelle.
7) Couleurs yūsoku : programmation scénique
La logique yūsoku (有職) assigne des couples chromatiques codés ; quelques usages efficaces pour la scène :
- Rouge cramoisi + or : auguste/auspicieux, idéal pour entrées solennelles (bugaku saho, dévoilements kabuki).
- Bleu-vert/vert : seuils, passages, personnages « liminaux » (messagers, esprits bienveillants).
- Blanc + argent : sacralité, deuil noble, ou révélation (hikinuki).
- Vermillon + noir : autorité rituelle, tension (prélats, régents).
Le contraste mat/brillant (nuihaku) importe autant que la teinte : il guide l’œil sous faible intensité (Nō) comme en lumière dure (kabuki).
8) Études de cas (micro-dramaturgies)
- Aoi no Ue (Nō) – Dame de cour possédée : karaginu-mo assombri + surihaku argent → noblesse entravée ; le brillant ne signe pas l’ostentation mais la présence d’un autre plan (esprit).
- Danse de Ranryō-ō (Bugaku / relecture kabuki-buyō) – Silhouette rouge armoriée, épaules architecturées : la frontalité du costume dicte un kata rectangulaire (peu d’angles arrondis), attaques sur temps forts du shō.
- Scènes Genji au kabuki – Hikinuki de jūnihitoe : la cascade de couches matérialise la métamorphose narrative (identité courtisane → apparition florale, p. ex. glycine).
9) Pour les compagnies d’aujourd’hui : adapter sans trahir
- Poids cible : 3,5–5 kg pour un « jūnihitoe de scène » jouable ; réserver les pièces >7 kg pour tableau statique.
- Modules : fabriquer des pans de mo amovibles (pression textile) pour transitions rapides.
- Kanmuri : coiffe en résine laquée + laçage élastiqué intérieur pour stabilité ; shaku en bois léger (paulownia) protégé par vernis gomme-laque.
- Éthique visuelle : privilégier les motifs yūsoku documentés plutôt que des « dragons génériques » ; la lisibilité d’époque se gagne par la cohérence des familles de motifs et non par la surcharge.
10) Mini-glossaire
- Kyūtei-fuku (宮廷服) : vêtements de cour (au sens historique) et, par extension, leurs versions scéniques.
- Yūsoku-mon’yō (有職文様) : motifs aristocratiques codifiés.
- Sokutai / Ikan : tenues cérémonielle / de cour pour hommes.
- Jūnihitoe / Karaginu-mo : système féminin de couches / manteau court + train.
- Sashinuki : pantalon bouffant à ourlet froncé.
- Kanmuri / Shaku : coiffe laquée / bâton de commandement.
- Karaori / Atsuita / Noshime : familles de robes Nō.
- Nuihaku / Surihaku : or/argent en feuille appliqué + broderies.
- Hikinuki / Bukkaeri : techniques de déshabillage/métamorphose sur scène.
Conclusion
Aborder le kyūtei-fuku sur scène, c’est orchestrer une grammaire politico-rituelle héritée de la cour qui, transposée, structure le temps, l’espace et la gestuelle. La réussite ne tient pas à « reconstituer » à l’identique, mais à composer – avec justesse – poids/silhouette, couleurs yūsoku, motifs et gestes de sorte que le rang et la temporalité aristocratique rayonnent dans la dramaturgie. Pour des spécialistes, le défi est moins textile que sémiotique : faire parler le costume à la vitesse du théâtre.